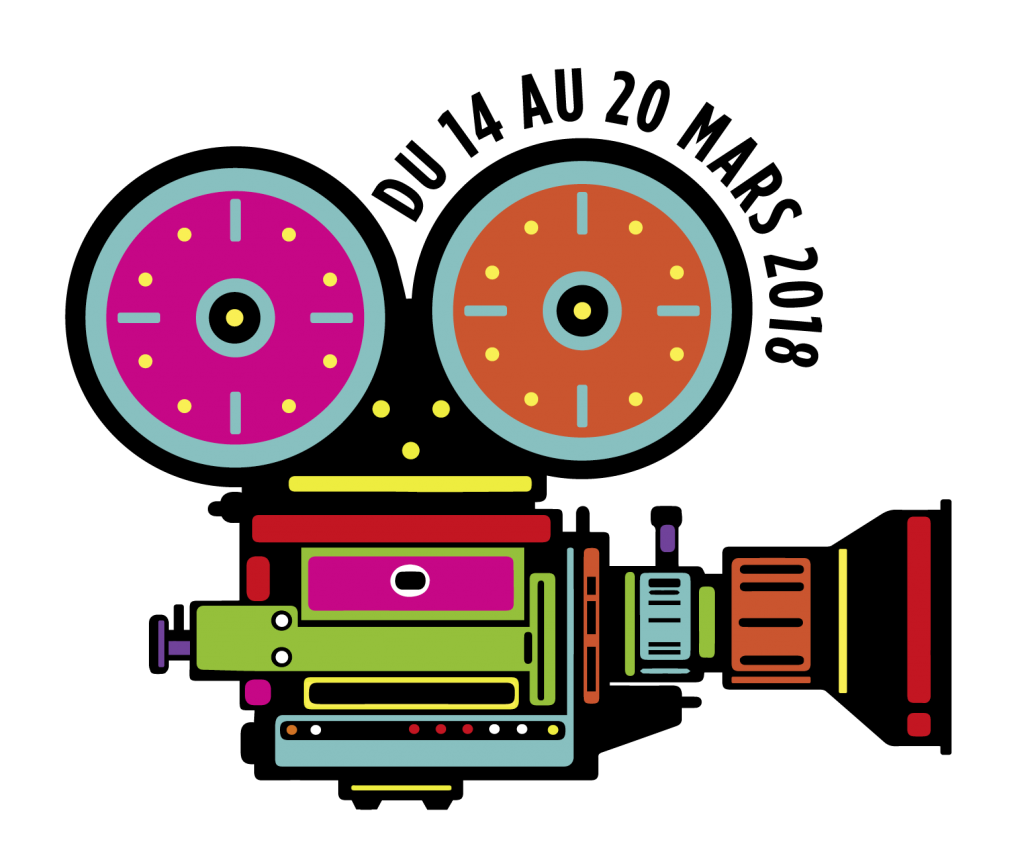JEUDI 29 MARS 2018 à 20 h▶ Deux films de Laetitia Mikles
Kijima stories,
Et là-bas souffle le vent
de Laetitia Mikles

Kijima stories
France – 2013 – 31′
M. Kijima n’est plus un yakuza, clame le journal local de Sapporo. Mais est-ce bien vrai ? Un mystérieux dessinateur mène son enquête dans le nord du Japon à la recherche de l’ex-mafieux. Au fil des rencontres, l’enquête se double d’un autre récit, entièrement visuel, composé de dessins et de séquences furtives d’animation.
Entretien avec Laetitia Mikles
Christophe Chauville – Comment avez-vous été amenée à la réalisation de films documentaires ?
Laetitia Mikles – Je viens des sciences humaines et sociales : la sociologie, l’ethnologie. J’ai commencé à me passionner pour le documentaire à l’époque de mes études, en particulier pour le travail de Jean Rouch ou le “cinéma direct” de Pierre Perrault. Je suis vraiment passée à la réalisation en répondant à un appel d’offre lancé par France 3 et l’INA autour du thème du combat, à travers un documentaire de création : Lucie va à l’école, sur l’intégration scolaire d’une petite fille trisomique dans une école maternelle ordinaire. À l’origine, j’avais rencontré sa mère dans un train et elle m’avait raconté son histoire et l’évolution de son propre regard sur son enfant.
 C.C. – Une telle matière « humaine » est-elle toujours à l’origine de votre inspiration au moment de vous lancer dans l’écriture d’un film ?
C.C. – Une telle matière « humaine » est-elle toujours à l’origine de votre inspiration au moment de vous lancer dans l’écriture d’un film ?
L.M. – Mes envies de films naissent le plus souvent du hasard, de rencontres. Quand j’étais au Japon afin de réaliser un film sur Naomi Kawase, je me suis promenée à travers le pays et, par l’intermédiaire d’amis francophiles, j’ai entendu parler d’un yakuza étant devenu moine. Ce changement de vie me semblait tellement radical que j’ai eu envie de partir à sa recherche, afin de savoir ce qui s’était réellement passé. L’idée était aussi de rencontrer des personnes ayant eu un lien avec ce M. Kijima ou réagissant à son itinéraire. Je connaissais donc déjà pas mal de choses le concernant avant de le rencontrer en personne, tout en n’étant absolument pas certaine de pouvoir le retrouver, ni qu’il accepterait de me parler, surtout devant une caméra… Mais le plus angoissant, c’était d’aller au-devant de Japonais pour les faire parler d’un sujet qui reste tabou chez eux, les mafias. Finalement, des gens sont venus d’eux-mêmes engager la conversation, très curieux de savoir ce que pouvaient bien faire des Français dans ces coins perdus de l’île d’Hokkaido.
C.C. – Aviez-vous une attirance particulière pour la culture japonaise, au point de vouloir partir en résidence d’artiste à la Villa Kujoyama de Kyoto ?
L.M. – On me pose toujours cette question, y compris lors du jury final de cette résidence, mais non, je n’avais aucun attrait spécifique, je voulais seulement faire un film sur Naomi Kawase. Au fil de mes différents voyages là-bas, j’ai bien entendu appris à connaître petit à petit le pays, même s’il demeure mystérieux. On y ressent souvent une perte totale de repères, qui assez déstabilisante et c’est ce qui me plaît…
C.C. – Pourquoi avoir choisi cette forme hybride, intégrant des passages animés, pour Kijima Stories ?
L.M. – En la personne de M. Kijima, j’avais le sentiment de rencontrer une figure de fiction, d’entrer à l’intérieur même de la toile ; je ne pouvais même pas croire qu’il puisse exister dans la réalité ! Et puis j’avais aussi en tête un spectacle de « kamishibai », le théâtre de papier japonais, auquel j’avais assisté, avec cette base de dessins servant à un conteur. Je désirais fondre dans mon film ces deux inspirations, d’où le recours à un dessinateur. Je ne souhaitais toutefois pas réaliser un documentaire animé, mais juste introduire des séquences d’animation. Comme si mon dessinateur était tellement happé par la quête du personnage qu’il devenait un peu fou et perdait pied avec la réalité. Je voulais que ces séquences perturbent le spectateur et je pensais aux animations – magnifiques – du Russe Alexandre Petrov, en peinture sur verre. C’est une technique virtuose, parmi les plus difficiles : la moindre erreur ne peut être rattrapée, c’est un exercice sans filet… Et cette idée me plaisait beaucoup : ajouter du risque dans le documentaire, qui l’est déjà beaucoup et qui joue en permanence avec l’inattendu et la nécessité de devoir s’adapter, quand bien même le tournage aurait été parfaitement préparé en amont…
Et là-bas souffle le vent
France – 2015 – 59′
Des chemins, Laurent Pariente en a suivi de toutes sortes.
Le chemin tortueux de la fugue, très jeune. Puis, très vite, les chemins obliques de la création plastique. Laurent a offert aux spectateurs des parcours labyrinthiques dans lesquels perdre pied. Des dédales d’argile, des labyrinthes de craie…
Un jour, Laurent Pariente a bifurqué : il est devenu chef cuisinier à New York. On ne se promenait plus dans son œuvre, on la goûtait, on l’absorbait.
Pour lui, ces tracés multiples forment un seul et même parcours ; il continue de creuser le même sillon de la création, et de l’émerveillement.
Laura Angot – Vous avez rencontré Laurent Pariente en 2007 à la Villa Kujoyama, lors d’une résidence d’artistes. Pourriez-vous raconter ce moment ?
Laetitia Mikles – J’ai rencontré Laurent à la Villa Kujoyama, une résidence d’artistes à Kyoto. Son studio était voisin du mien. Il m’a invité à boire un thé. Sa fenêtre donnait sur une horrible petite cour bétonné et noyée dans la lumière blafarde de l’hiver. Mais lui ne voyait pas cela. Il imaginait déjà comment il allait transformer la cour : des grosses pierres de rivière sur lesquelles il coulerait de l’aluminium en fusion qui, en se figeant, recouvrirait la rocaille de lumière argentée. Il planterait un vieux pin tordu arraché à la montagne qui se reflèterait dans cette cascade d’argent immobile. Il avait rêvé tout un jardin, un vrai bijou, inspiré des traditionnels jardins secs japonais. C’est ce qui m’a touchée chez Laurent : cette capacité d’imaginer la beauté dans un lieu vide et insignifiant.
L.A – Lors d’un interview accordée à la revue numérique Eclairs en 2014, vous dites ne jamais avoir vu directement une des œuvres monumentales de Pariente. Est-ce donc à la base plus une envie de faire un film sur l’homme que sur l’artiste ?
L.M – Nous voulions travailler ensemble, faire un film. Mais ce projet a beaucoup changé, au gré des projets et des péripéties de vie de l’un et de l’autre. A tel point que j’ai dû repenser le film quatre ou cinq fois. Le grand défi était en effet de réaliser un film sur quelque chose qui n’existe plus puisque la plupart des œuvres de Laurent, pour monumentales qu’elles soient, étaient conçues pour être éphémères : elles étaient détruites une fois l’exposition terminée. Il fallait retrouver des traces (filmées, photographiées) de ses œuvres… Mais surtout inventer des supports pour l’imagination du spectateur, qu’il parvienne lui-même à se faire une idée du travail de Laurent, grâce à des éléments évocateurs : des chemins, des parois, de la lumière…
L.A – Dans le film, Pariente affirme que ‘’la rencontre de l’autre devrait être (quelque chose) de
perturbant’’. Qu’en a-t-il finalement été de la rencontre de votre caméra avec lui ?
L.M – Laurent est pudique. Je suis timide. Notre rencontre a forcément été perturbante et émouvante l’un pour l’autre… Nous ne nous sommes jamais fréquentés assidûment, mais avons toujours été heureux de nous retrouver. Chacune de nos rencontres était vraie. Avec Laurent, il n’y a pas de bavardage léger : on va très vite au cœur des choses. Lors du tournage, nous ne disposions que de peu de temps et c’était très bien ainsi. Ce temps court, dense et intense a été propice à la confidence. Même si je le connaissais depuis des années, la rencontre avec Laurent a vraiment eu lieu à ce moment-là : Laurent s’est livré avec sincérité, confiance, et presque naïveté. Ce qu’il dit sur l’absolue implication de l’artiste dans son œuvre, sur sa constante mise à nu, sur sa prise de risque incessante ne sont pas de vaines paroles : c’est ce qu’il a fait pendant tout le tournage.
L.A – L’artiste avoue également que « montrer la fragilité dans (son) œuvre est quelque chose d’important ». Dans votre travail de réalisatrice, cette notion l’est-elle tout autant ?
L.M – En réalisant des documentaires, je laisse parler les autres à ma place. Ce sont eux qui acceptent de se dévoiler devant la caméra. Moi, je me planque. Je pense que c’est le cas de beaucoup de cinéastes qui choisissent le documentaire pour s’exprimer. En donnant la parole aux personnes qui nous touchent, qui nous questionnent, nous, documentaristes, brossons souvent notre propre autoportrait en cachette. Et finalement, c’est sans doute un ultime aveu de fragilité, non ?
L.A – Durant toute la première moitié de votre film, Pariente n’est jamais filmé de face. Essentiellement de dos, au mieux de trois-quarts. Comme si la caméra, et donc indirectement le spectateur, le suivait secrètement sans chercher à être démasqué. Est-ce là pour vous une façon de simuler un schéma cherchant à montrer ce qui n’aurait pu être vu autrement ?
L.M – J’avais envie de créer du désir pour ce personnage qui marche sans que l’on sache où il va, ni qui il est. Créer de la curiosité pour un personnage qui se dévoilerait peu à peu. Cela met le spectateur dans une forme de tension : tout n’est pas offert à son regard. Soit il doit patienter, soit il doit imaginer. Filmer un visage ne devrait jamais être un geste anodin.
L.A – D’ailleurs comment réalise-t-on un film sur un artiste à l’oeuvre si hybride, hétéroclite ? A-t-on une trame et un scénario bien prédéfinis ou se laisse-t-on au contraire porter progressivement par les mots et les souhaits de cet homme / artiste devenant le temps de votre film votre acteur ?
L.M – En effet, le temps de ce film Laurent le créateur est devenu une sorte d’interprète. Parfois avec Nicolas Duchêne, le chef-opérateur, nous lui donnions des indications assez contraignantes : marcher de telle façon, à telle vitesse, avec tel sentiment… Tout en permettant à la liberté de Laurent de se déployer. Donc le film a navigué entre ces deux pôles : un travail en amont très écrit, très préparé (repérages, rencontres avec les trois témoins essentiels au film : Jean-François Dumont, David Quéré et Cyrille Maury). Mais aussi de la place pour accueillir ce qu’on ne peut pas prévoir et qui fait la beauté des films documentaires : un jeu de lumière, un bout de paysage découvert fortuitement, une pensée qui se crée sur le moment…
L.A – Durant une grande partie de votre film, Pariente se balade dans un paysage mousseux, à la végétation verdoyante, au milieu des grottes, là où la lumière se glisse entre le feuillage des arbres et les hautes parois rocheuses du paysage. Cela apporte beaucoup de poésie à la narration…
L.M – Les constructions labyrinthiques de Laurent n’existent plus. Les descriptions orales ne suffisent pas. Il fallait un support visuel puissant pour éveiller et développer l’imagination du spectateur. Dans le film, c’est le spectateur qui fait tout le travail : il est invité à créer ses propres images mentales, à projeter sa propre vision de l’oeuvre de Laurent sur le parcours géologique que lui propose le film. Les parois des falaises d’Excideuil, rugueuses et grises permettent d’évoquer les murs de craies lisses et blancs de Laurent. L’idée était de créer un écart entre le vrai et l’imaginé, entre ce qui n’est plus et ce que l’on voit.
L.A – L’omniprésence de la grotte, la découverte de peintures pariétales, leur importance aux yeux de l’artiste… Ne sommes-nous pas là en plein dans l’Allégorie de la caverne de Platon ?
L.M – Chaque artiste a une obsession qui le travaille obscurément. Une obsession qui est en fait la clé de voûte invisible de son œuvre. Après en avoir discuté avec Laurent, j’ai fait le pari que son amour secret pour les grottes et les cavernes préhistoriques était une clé cachée pour entrer dans son œuvre… ce qui est loin d’être évident quand on connait son travail. Dans le film, Laurent explore un gouffre noir. Les ténèbres l’entourent et puis soudain, en hauteur, on distingue une percée de lumière. C’est une ouverture mystérieuse, la promesse d’un passage, une invitation à aller voir derrière le paravent de l’immédiatement visible.
ITW menée par Laura Angot pour la revue FILAF Annual N°4 – janvier 2016

Les projections en entrée libre – dans la limite des places disponibles – se déroulent à Paris, dans le 2e arrondissement, près de la rue Montorgueil :
Salle Jean Dame, Centre sportif Jean Dame17 rue Léopold BellanMetro : Sentier (L3) ou Les Halles